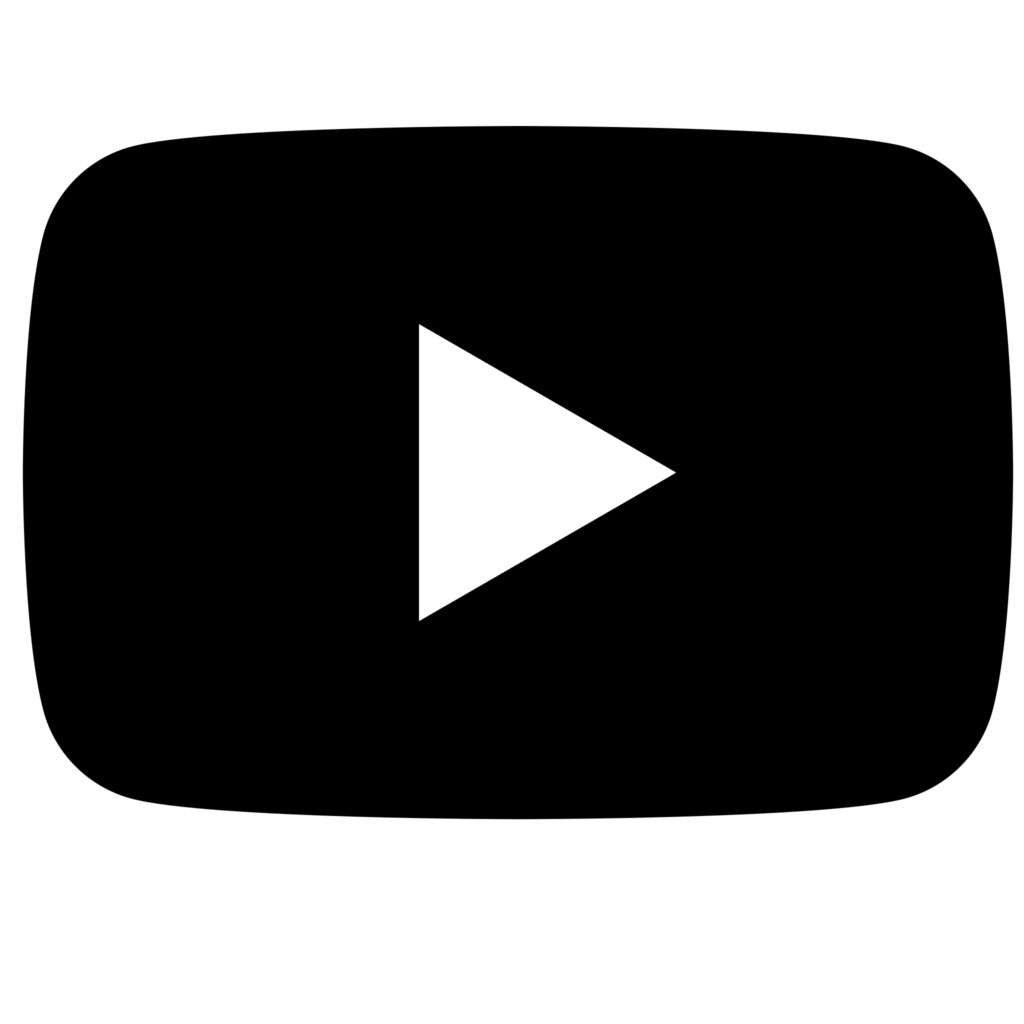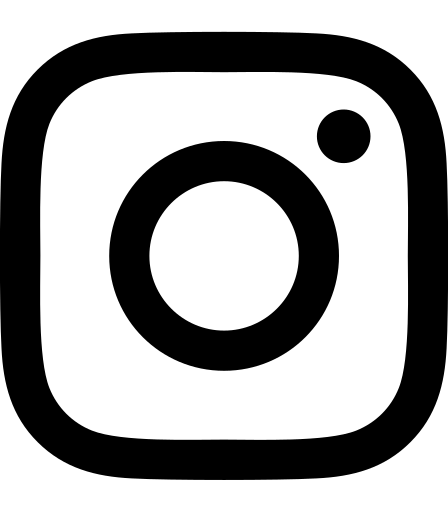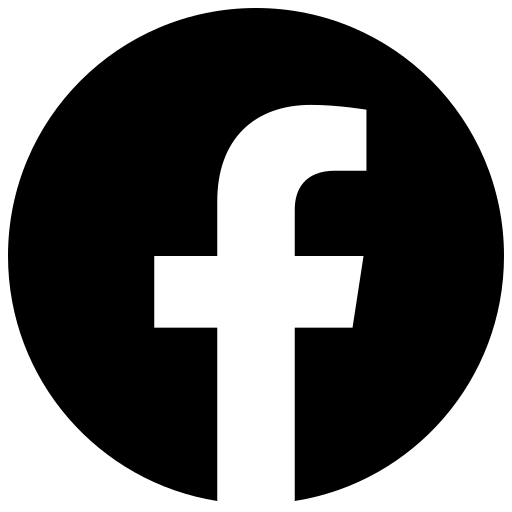Fabriques de soie d’exception
La Galicière est une ancienne usine de moulinage de la soie de la fin du XVIIIe siècle, située à Chatte, dans le département de l’Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Son état de conservation et la présence de machines datant de la révolution française en font « une capsule de temps », unique en France, voire en Europe.
La filature, la forge, la magnanerie, les installations hydrauliques et la machinerie sont inscrites au titre des monuments historiques par arrêté du 2 mars 2004.



Histoire
L’industrie du textile en Isère
Sous l’Ancien Régime, le travail du textile occupe en une place majeure dans l’industrie du Dauphiné, comme celle du reste du royaume. La forte présence d’élevage de moutons et la forte présence de chènevières engendrent très vite le développement du tissage des draps de laine et des toiles de chanvre.
En savoir +
Durant tout le XVIIIe siècle, des centres d’élaboration et de préparation des fils de soie naissent un peu partout en Dauphiné, allant jusqu’à détrôner l’activité de tissage en déclin à partir des années 18204. Les soies produites dans la province sont particulièrement recherchées par les marchands de Lyon, de Saint-Étienne, d’Alès et de Nîmes5. À la fin du XVIIIe siècle, le Dauphiné est des premiers centres français de filature et de moulinage de la soie.

Bâtiments
Le site de la Galicière est très représentative de l’architecture des nombreuses usines de moulinage d’Isère, d’Ardèche, de la Drôme ou de la Loire dans la mesure où ses bâtiments présentent une morphologie typique des constructions abritant le travail de la soie. Chaque opération s’exerçait dans un bâtiment distinct et facilement identifiable.

Implantation géographique
L’implantation géographique d’un moulinage dépendait essentiellement de son alimentation en eau et de la hauteur de chute disponible pour faire tourner les roues hydrauliques. C’est pourquoi, la Galicière s’est développée à l’emplacement même d’un ancien moulin attesté dès 1651, et d’un site romain répertorié par Hippolite Müller, fondateur du Musée Dauphinois.La Galicière fait partie des moulinages qui se sont adjoints les opérations intermédiaires de transformation de la soie comme l’éducation des vers à soie dans la magnanerie ou le tirage des cocons dans la filature.
+ Magnanerie
Au XVIIIe siècle, l’élevage de vers à soie était une activité saisonnière qui représentait une ressource financière substantielle et surtout un apport en numéraire pour les agriculteurs.
Elevage et filature se pratiquaient à la ferme, en empiétant parfois sur l’espace d’habitation. La produc-tion de soie grège était ensuite vendue au moulinier.
Mais l’éducation du ver à soie requiert une grande disponibilité en hommes, et des locaux adaptés aux exigences d’hygiène et de ventilation nécessaires à une bonne éducation à plus grande échelle.
Au cours du XIXe siècle, les mouliniers soucieux de contrôler leur approvisionnement en cocons font construire dans l’enceinte de leur moulinage, un bâtiment dédié à l’éducation des vers à soie. La sériciculture se pratique dorénavant dans la magnanerie, vaste et haute pièce équipée de procédés de régulation thermique et de ventilation car lever exige un équilibre hygrométrique qui varie avec son âge.
Contrairement aux salles d’ouvraison semi-enterrées à grande inertie thermique, la magnanerie de la Galicière de 6 m x 11 m, se développe sur une double hauteur, entre la Fabrique Haute et le réfectoire à l’instar d’un bâtiment pont.
Exposée nord-sud, elle est pourvue de larges fenêtres aux volets à persiennes atténuant l’impact direct des rayons solaires et les courants d’air.
Aux angles, des cheminées pallient aux baisses de température qui risquent d’être fatales pour les vers à soie. A l’intérieur, une structure primaire en bois supporte des claies de bois horizon-tales ajourées occupant tout le volume disponible.
A mi-hauteur, l’accès aux claies supérieures est assuré par un plancher suspendu.
+ Étouffoir à cocon
La chrysalide emprisonnée dans son cocon va être soumise à une très forte température dans un espace dédié, l’étouffoir.
Il s’agit d’un édicule en briques réfractaires équipé d’étagères sur lesquelles étaient disposés des paniers très plats remplis de cocons.
À la Galicière, dans la forge, le four à cocons est toujours en place. Il était pro-che de la machine à vapeur, aujourd’hui disparue.
+ Filature
Au XIXème siècle, on voit apparaître des bâtiments spécifiques dans le but de contrôler la qualité et la quantité de la matiè-re première des moulinages : la soie grège. Peu à peu, la filature industrielle prend le pas sur le filage familial.
La filature est un bâtiment spécifique affecté au tirage du cocon, activité autonome mais connexe au programme moulinier.
En prolongement de la Fabrique Haute, la filature est facilement identifiable par sa haute cheminée en tuf et sa façade est largement vitrée.
Cette verrière qui assurait l’éclairage naturel indispensable au tirage du fil de soie est composée d’une succession de structures métalliques légères.
Elles pivotent sur un axe vertical, séparés par de frêles pilastres de tuf soutenant la toiture.
Encore visi-ble au dessus des baies, un store intérieur en tissu mouillé servait à rafraîchir la salle et à maintenir une atmosphère saturée en humidité.
+ Le gruoir
Au bout de la filature, un édicule séparé du reste de la Fabrique abrite une sorte de mortier en pierre ayant pu servir au broyage des chrysalides : le gruoir. Le jus nauséa-bond ainsi obtenu était ajouté à l’eau chaude de la filatu-re pour activer la dissolution du grès et faciliter le dévi-dage des cocons.
+ Les latrines
Entre la filature et le gruoir, un couloir à ciel ouvert mène un peu plus bas à un petit bâtiment indé-pendant : les latrines de la filature.
Ce passage entre deux murs d’enceinte servait-il un besoin d’intimité ou la crainte d’une fugue des ouvrières ?
Les latrines des Fabriques se trouvaient à l’entrée du réfectoire, d’autres encore ont été repérées sous l’abri de la cour fermée par le dortoir.
Elles consistaient en une série de box fermés par une petite porte en bois, le tout situé sur une fosse reliée au canal d’eau.
+ Salle d’ouvraison
Les deux tâches principales de l’ouvraison sont le dévidage et le moulinage. Pour être travaillée, la soie doit être souple et légèrement collante. La température élevée entre 20° et 25° ainsi que l’hygrométrie autour de 80 % doivent pouvoir être contrôlées. Grâce à l’épaisseur de ses murs et sa situation semi-enterrée, l’atelier présente une très grande inertie thermique. On y accède par un sas en descendant trois marches et les fenêtres bien que de belles dimensions (1,2 × 2 m) ne s’ouvrent pas. Lorsque la température chute, il faut chauffer la salle avec des poêles à charbon.
Le couvrement voûté badigeonné de blanc de la salle de dévidage de la Fabrique Haute contribuait à l’équilibre hygrométrique et autorisait l’installation de banques de dévidage supplémentaires sur la tribune (mezzanine). Les ouvrières y accédaient par un petit escalier de bois interne. Le contremaître disposait d’un accès direct à la tribune au niveau de son bureau.
Les deux salles successives d’ouvraison occupent une superficie au sol de 8 × 28 m. Les machines remplissent totalement l’espace. La Fabrique Haute contrairement à la Fabrique Basse dispose d’un dégagement latéral de 1,20 m de passage le long des dix baies laissant filtrer la lumière de l’est. Le long de la façade ouest aveugle, court un caniveau technique et son arbre de transmission qui alimente les deux salles en énergie.
Les moulins semblent avoir été conçus en fonction du volume disponible tant leur occupation de l’espace est optimisée. D’une largeur de 5,57 m, donc assez courts par rapport à la norme, ils se développent sur toute la hauteur de la salle soit 4,80 m. Ils sont reliés deux à deux par un palier en bois commun sur lequel se tenaient les moulinières. Le plafond plat en poutres de bois et voûtains de brique de la salle des moulins participe à la rationalisation de l’espace. Une question subsiste : était-ce voulu, ou est-ce simplement la partie la plus ancienne du bâtiment ? Dans la Fabrique Basse, moulinage et dévidage occupent deux étages distincts séparés par un plancher plat en bois avec une sous-face en lattis plâtrés. Les moulins plus encombrants se trouvent au rez-de-chaussée. Là aussi, les machines occupent tout l’espace disponible. Les moulins de 3,50 m de haut vont du sol au plafond. Une nacelle coulissante permet l’accès à la partie supérieure des moulins. D’une longueur plus conventionnelle de 7,36 m, ils sont actionnés par le sommet en leur milieu. La roue hydraulique se situe toujours à proximité immédiate des machines consommant le plus d’énergie, en l’occurrence les moulins. Celle de la Fabrique Haute est cachée par un escalier en bois menant directement à la magnanerie. Une porte en bois à deux vantaux surmontée d’une imposte vitrée marque l’entrée de l’usine, de la cage à roue, de la magnanerie et de l’appartement du contremaître.
+ Logement
Machines et logement cohabitent sous le même toit : les ouvertures de gabarit identique suivent un ordonnancement commun. L’emprise de l’habitation résulte de l’architecture de l’atelier situé juste en-dessous. Long et étroit, un couloir distribue une batterie de pièces en enfilade. Les pièces équipées de cheminées sont d‘un décor sobre mais soigné. L’appartement du propriétaire et celui du contremaître occupent tout le premier étage de la Fabrique Haute. Avant l’adjonction de la filature, une porte à l’encadrement monumental en pierre représentant un drapé donnait directement accès au chemin à l’arrière du bâtiment. Il s’agissait vraisemblablement de la porte principale de la Fabrique.
+ Galetas
Le galetas, servait de salle de grainage. Les entraits de la charpente ont été retroussés pour laisser place à la structure de bois supportant les claies. Les ouvertures en forme d’oculi présentent un judicieux système de châssis entoilé ouvrant à guillotine et assurant la régulation d’entrée d’air et de lumière. Les ouvrières y accédaient par l’escalier menant à la magnanerie alors que le directeur disposait d’un accès direct à partir de son logement. Le galetas de la Fabrique Basse abritait un dortoir. Un portillon à sellette sur le mur mitoyen entre deux chambres servait vraisemblablement de judas à la surveillante.
+ Le dortoir
Les ouvrières étaient logées sur place dans un bâtiment destiné à cet effet fermant la cour entre la Fabrique Basse et le réfectoire. Ce dortoir de 38 lits en pisé menaçait ruine et a dû être démoli.
Une topologie architecturale
L’analyse morphologique des moulinages en Rhône-Alpes dirigée par Bernard Duprat a mis en évidence trois constantes principales dans l’organisation spatiale interne et le rendu architectural des moulinages.
+ Archétypes
Un archétype d’édifice s’impose répondant aux contraintes du travail de la soie.
1- Un corps de bâtiment principal flanqué de bâtiments annexes.
2- L’étagement typique des moulinages avec l’atelier en rez-de-chaussée, l’appartement du propriétaire au-dessus et le galetas sous les combles abritant le stockage ou le dortoir.
3- La forme de couvrement des ateliers : soit deux salles successives couvertes d’une voûte en berceau à lunettes simples soit à deux niveaux séparés par un plancher plat. La particularité de la Galicière est de présenter sur un même site ces deux types de couvrement des ateliers. Semi-enterré en contrebas du terrain naturel, l’atelier de moulinage bénéficie ainsi de l’inertie thermique naturel-le du sol.
+ Vaucanson
On retrouve toutes ces caractéristiques au moulinage de la Galicière, y compris celles relatives aux dimensionnements des salles. Elles rappellent les recommandations techniques et architecturales énoncées par Vaucanson à partir de 1750 et expérimentées dans les Manufactures Royales comme celle de la Sône en 1773. Avec l’architecte mécanicien Aubry, Vaucansson allait mettre au point une typologie d’édifices répondant aux contraintes de leurs fonctions.
+ Typologie
L’ensemble industriel de la Galicière tel qu’il apparaît aujourd’hui résulte de l’agrégation de deux fabriques bien distinctes : Fabrique Haute et Fabrique Basse. Chacune d’elles avait sa propre entrée, sa propre roue hydraulique, son propre jardin et jusqu’en 1885 elles appartenaient à deux propriétaires différents.
Chacune de ces deux fabriques est représentative des deux typologies architecturales des moulinages :
La Fabrique Haute avec ses deux salles successives et sa couverture voûtée en forme d’anse de panier et sa tribune. La Fabrique Basse avec ses deux salles des machines réparties sur deux niveaux séparés par un plancher plat en bois.
+ Regroupement
De surcroît, l’activité de moulinage s’est adjoint les phases de production et de préparation de la soie grège, magnanerie et filature.
Sur un même site sont regroupées toutes les phases de production du fil de soie, du grainage au moulinage.
Pour finir, la richesse de cette Fabrique tient au fait d’avoir conservé ses machines dans ses ateliers. Au moment du déclin de l’industrie soyeuse, presque partout ailleurs les machines en bois, facilement démontables et devenues inutiles ont été remplacées par d’autres.
En 1889, Marc Louis Crozel envisage même de reconvertir les moulinages de la Galicière en tissage. Faute d’avoir pu réunir les fonds à temps, le projet achoppera, et les Fabriques finiront par fermer l’une après l’autre, la Haute en 1914 et la Basse dans les années 20.
A la Galicière, tout est resté en place à la faveur d’une jeune fille unique qui mourra sans descendance.
Deux fabriques
L’usine de moulinage de la Galicière est née du regroupement de deux fabriques établies à quelques dizaines de mètres l’une de l’autre, de part et d’autre d’un vaste quadrilatère. Nommées respectivement Fabrique Haute et Fabrique Basse, elles sont acquises en 1855 par deux négociants lyonnais, Romain Deprandière et François Fleury Cuchet. L’acte de vente concernant la Fabrique Haute fait mention d’une magnanerie, d’une forge et d’un dortoir pour les ouvrières de 38 lits. Dès cette époque, l’usine est dirigée par François Cuchet, assisté de son gendre, Joseph Louis Marc Crozel. Travaillant à façon pour la Maison Deprandière et Maurel à Lyon, l’entreprise est manifestement fructueuse et appelée à un certain
développement.
+ Troisième usine de moulinage de l’Isère
En 1870, ce sont près de 600 tavelles, 6000 broches et 56 bassines qui garnissent les ateliers, plaçant ainsi l’usine au troisième rang des entreprises de moulinage du département, par l’importance de ses équipements. De cette période date très probablement la construction, au nord, des dortoirs et autres logements pour les ouvrières ainsi que de l’importante magnanerie qui clôt le site de ce côté. L’organisation de l’usine en deux espaces distincts se signalant chacun par une entrée, s’explique ainsi par l’histoire et l’évolution de cette dernière.
+ Cohérence et homogénéité
Pourtant, l’ensemble est d’une grande cohérence tant du point de vue du traitement des bâtiments que de la nature des matériaux de construction utilisés, et surtout très représentatif de l’architecture des nombreuses usines de moulinage qui peuvent être observées en Ardèche, dans la Drôme ou la Loire.
Edifiés en contrebas d’un terrain naturel, les bâtiments de fabrication forment de grands volumes, longiligne pour la Fabrique Haute, parallélépipédique pour la Fabrique Basse qui réunissent, sous un même toit, ateliers de moulinage et de dévidage au rez-de-chaussée, logements du directeur et des contremaîtres, dortoirs des ouvrières à l’étage, magnanerie dans les combles.
Pour des questions d’hygrométrie, l’atelier de moulinage est semi-enterré. Celui-ci bénéficie d’un éclairage latéral fourni par une série de baies situées en façade principale, ici orientée à l’est.
Ces bâtiments sont complétés, au sud, par la filature repérable par ses grandes
verrières en façade, le bâtiment de la chaudière à vapeur avec, à l’arrière, sa cheminée d’évacuation des vapeurs et enfin, au nord, les communs.
Tout aussi bien conservé est le système hydraulique, que ce soit le canal d’amenée d’eau, les roues, que les arbres de transmission qui donnaient aux machines leur mouvement.
Sylvie Vincent, conservateur en chef du patrimoine.
Réhabilitation et animations
En 1996, à la mort d’Anne-Marie Crozel, dernière descendante de la famille Crozel, l’usine, fermée depuis les années 20 est mise en vente. Elle est rachetée en 1997 par un couple d’architectes.
En 2000, ils créent l’association Les Amis de la Galicière. Dans un premier temps, leur objectif est de réhabiliter le site, afin de le rendre accessible public. Très vite des expositions, concerts, pièces de théâtres, projections et performances sont organisés comme Inconnus à la fenêtre, exposition de photos prises par le chanoine Crozel entre 1899 et 1911, Soie d’Alessandro Baricco ou encore Soie dite en chantant, pièce de théâtre écrite par Pierre Lecarme, spécialement pour La Galicière.
Le site est ouvert au public chaque année lors des Journées du Patrimoine ou sur rendez-vous.
En février 2003, l’association Les Amis de la Galicière reçoit le Grand Prix rhônalpin du patrimoine pour le projet de reconversion de la magnanerie en salle d’exposition et de réception.
L’année suivante, les bâtiments de la Galicière sont inscrits au titre des Monuments historiques, complétée en 2007 par l’inscription des machines.
En 2015 le site de la Galicière est labelisé Ensemble Industriel Remarquable par Patrimoine Aurhalpin.
En 2022 VMF prime la restauration réalisée en 2019 et 2021.
En 2023 projet sélectionné par la Mission Bern